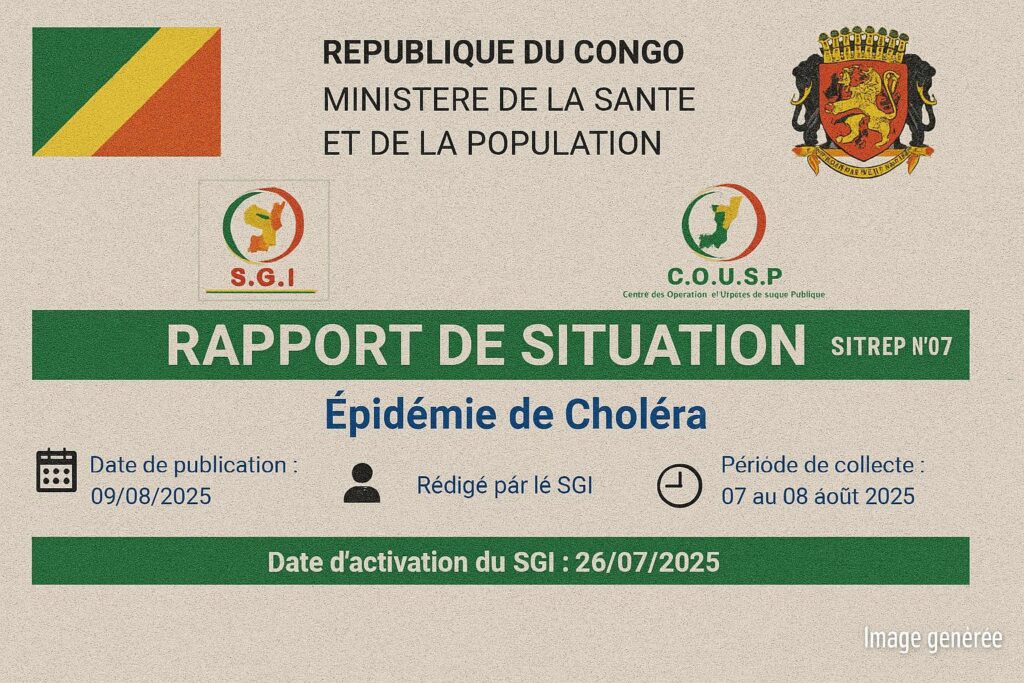Contexte sanitaire national
Au cœur de la saison sèche, la République du Congo doit composer avec un nouvel épisode de choléra dont l’intensité, bien que contenue, rappelle la vulnérabilité structurelle de certains bassins fluviaux. Selon les données consolidées au 9 août 2025, le pays a enregistré 327 cas confirmés et 18 décès, la majorité ayant été signalée dans les quartiers riverains de Brazzaville et dans le Kouilou (Ministère de la Santé, 2025). Cette poussée intervient après deux années de répit relatif, durant lesquelles les efforts de renforcement des réseaux d’adduction d’eau et de surveillance communautaire avaient réduit la transmission. La dynamique actuelle, jugée « préoccupante mais maîtrisable » par le Centre inter-États de veille sanitaire, impose néanmoins un redéploiement des ressources déjà mobilisées sur d’autres fronts épidémiques tels que la rougeole ou la dengue émergente.
Cartographie des cas et tendances
L’analyse géospatiale réalisée par le Laboratoire national de santé publique révèle trois foyers principaux : Mpila, Mfilou et Songolo. Ces zones partagent des caractéristiques socio-environnementales convergentes, notamment une densité démographique élevée et un accès inégal à l’eau potable. Les modélisations statistiques suggèrent un taux d’attaque plus élevé chez les 15-29 ans, tranche d’âge la plus mobile et la plus exposée aux points d’approvisionnement informels. Toutefois, le pic hebdomadaire observé fin juillet semble amorcer une phase plateau grâce aux interventions ciblées de chloration de puits et de dépistage systématique aux postes frontières fluviaux. Les experts de l’OMS soulignent que « la rapidité de détection constitue un atout essentiel pour briser les chaînes de transmission » (OMS, 2025).
Réponse coordonnée des autorités
Dès la publication du rapport de situation n°7, le gouvernement, en partenariat avec l’Agence française de développement et l’UNICEF, a activé un plan d’urgence assorti d’une enveloppe initiale de 2,5 milliards de francs CFA. Des cliniques mobiles sillonnent désormais les quartiers périphériques, tandis que 150 agents de santé communautaires ont été formés à la prise en charge précoce des déshydratations sévères. La direction générale de l’hygiène publique a, pour sa part, renforcé les contrôles des denrées sur les marchés ouverts, mesure saluée par les associations de consommateurs. « Nous avons voulu anticiper tout risque de panique alimentaire tout en rassurant la population », explique le Dr Irène Bouity, coordinatrice nationale du programme Eau-Hygiène-Assainissement.
Engagement citoyen et perspectives
Au-delà de la réponse institutionnelle, la réussite de la riposte repose sur un engagement citoyen accru. Dans les campus universitaires de Makélékélé, des collectifs d’étudiants en médecine organisent des sessions de sensibilisation sur les gestes barrières et la réhydratation orale. Sur les réseaux sociaux, le mot-dièse #ZéroCholéra circule dans un esprit de solidarité et de pédagogie, invitant la jeunesse à relayer les alertes officielles plutôt que les rumeurs. Les projections épidémiologiques demeurent prudentes, envisageant un retour à la normale mi-septembre si le taux de letalité reste inférieur à 3 %. À moyen terme, la stratégie nationale d’assainissement prévoit la construction de 1 200 latrines écologiques supplémentaires, mesure inscrite dans le Plan national de développement 2022-2026 et conforme à l’Objectif 6 des ODD. Cette perspective, conjuguée aux innovations numériques de surveillance en temps réel, laisse espérer une résilience collective renforcée face aux épisodes hydriques à venir.