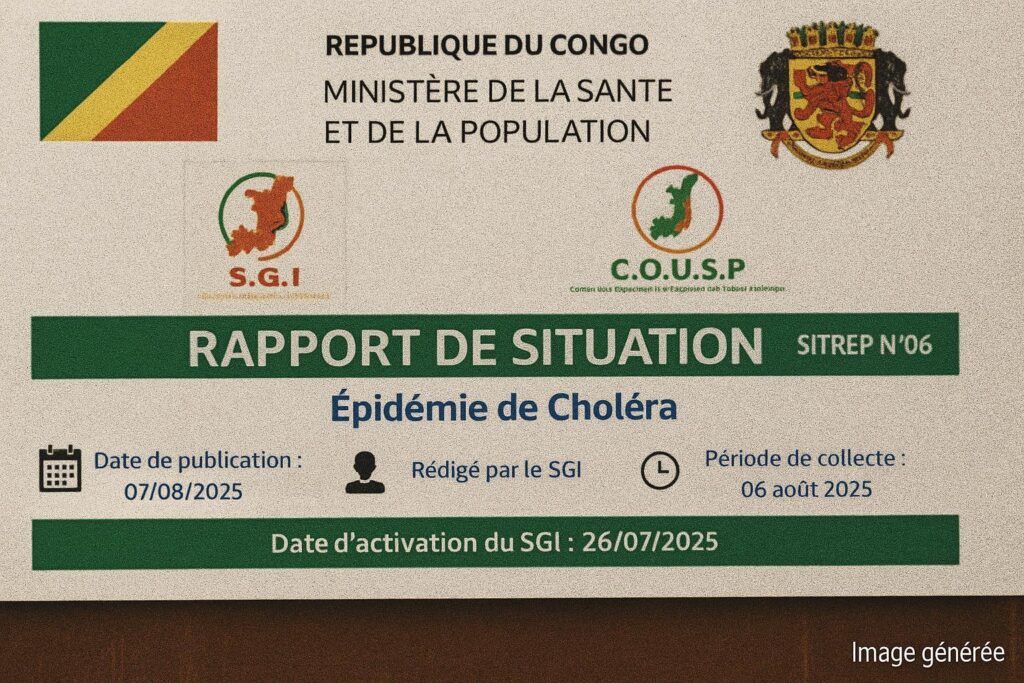Données épidémiologiques actualisées
Publié le 7 août 2025, le sixième rapport de situation consacre l’épidémie de choléra comme un défi sanitaire majeur et néanmoins contenu. Au total, 412 cas suspects, dont 156 confirmés en laboratoire, ont été notifiés depuis le début de la flambée en mai. Le taux de létalité, stabilisé à 8,7 %, demeure inférieur à la moyenne observée lors de la crise de 2017, signe d’une amélioration de la prise en charge (OMS, rapport de situation n°6). Pointe-Noire, Kouilou et, dans une moindre mesure, le district de Makélékélé à Brazzaville concentrent près de 72 % des notifications. Les investigations épidémiologiques attribuent cette répartition à la densité urbaine et aux échanges commerciaux côtiers, facteurs classiques de diffusion vibrionique.
Si la courbe hebdomadaire affiche une inflexion depuis deux semaines, les experts rappellent que la saison des pluies, attendue dès septembre, pourrait rebattre les cartes. « Nous sommes à un palier, non à l’épilogue », souligne le Dr Roselyne Ibata, épidémiologiste au Centre national de référence. L’appel à la vigilance demeure donc le mot d’ordre.
Riposte gouvernementale et partenariats
Sous la coordination du ministère de la Santé et de la Population, le plan de contingence déclenché en juin articule prise en charge rapide et prévention à la source. Trois centres de traitement spécialisés, dotés d’unités de réhydratation intraveineuse, fonctionnent désormais à plein régime dans les hôpitaux Adolphe-Sicé, Loandjili et Talangaï. Le gouvernement, en collaboration avec l’OMS et l’UNICEF, a expédié plus de 540 000 sachets de SRO et 1 200 kits WASH vers les zones les plus exposées.
La surveillance épidémiologique s’appuie sur la plateforme numérique Djeka Systo, lancée en 2023, qui permet aux personnels de terrain de transmettre en temps réel les fiches de notification. Un corridor sanitaire a en outre été instauré sur l’axe routier Dolisie–Pointe-Noire afin de conjuguer contrôle des transporteurs d’eau et sensibilisation des voyageurs. Les autorités insistent sur la transparence des données sanitaires, démarche saluée par la représentation de l’Union africaine qui y voit « un gage de confiance envers la population et les partenaires ».
Prévention communautaire et rôle de la jeunesse
Au-delà de la réponse institutionnelle, la dimension communautaire s’affirme comme un levier décisif. Les collectifs de jeunes, tels que l’initiative Kéllé-Clean ou le réseau numérique #SunguMaji (« protégeons l’eau » en lingala), multiplient campagnes de porte-à-porte, ateliers de fabrication de chlorateurs artisanaux et lives Instagram dédiés aux gestes barrières. « Parler santé dans le langage de notre génération, c’est désamorcer les fake news plus vite qu’elles ne se propagent », observe Maïssa Nzaba, étudiante en biologie moléculaire impliquée dans le projet.
Parallèlement, la diffusion d’émissions radiophoniques en langue locale sur Radio-Mayombe et la formation de relais communautaires féminins renforcent l’appropriation des messages. Les premiers retours d’enquête KAP (connaissances, attitudes, pratiques) indiquent une augmentation de 18 % de l’utilisation d’eau traitée dans les foyers visités au cours du mois de juillet.
Perspectives sanitaires et leçons retenues
À court terme, les experts privilégient une stratégie de « consolidation-surveillance » : consolider les acquis logistiques tout en étendant la surveillance aux districts ruraux pouvant servir de réservoirs silencieux. Le ministère a d’ores et déjà annoncé la commande de 300 000 doses de vaccin oral, destinée aux premières lignes que constituent les pêcheurs de la lagune et les commerçants transfrontaliers.
Sur le moyen terme, l’épidémie rappelle l’impératif d’investir dans les infrastructures hydrauliques. Le projet de station d’épuration de Ngoyo, dont la pose de la première pierre est prévue pour octobre, ambitionne de réduire de 40 % la charge bactériologique des effluents urbains d’ici 2027. « Le vibrion cholérique prospère sur nos défaillances structurelles ; corrigeons-les, et nous écrirons la dernière page de cette épidémie », résume le Pr Arnaud Mbemba, infectiologue à l’Université Marien-Ngouabi. Un optimisme pragmatique qui nourrit l’espoir, à condition que la mobilisation de tous ne fléchisse pas.