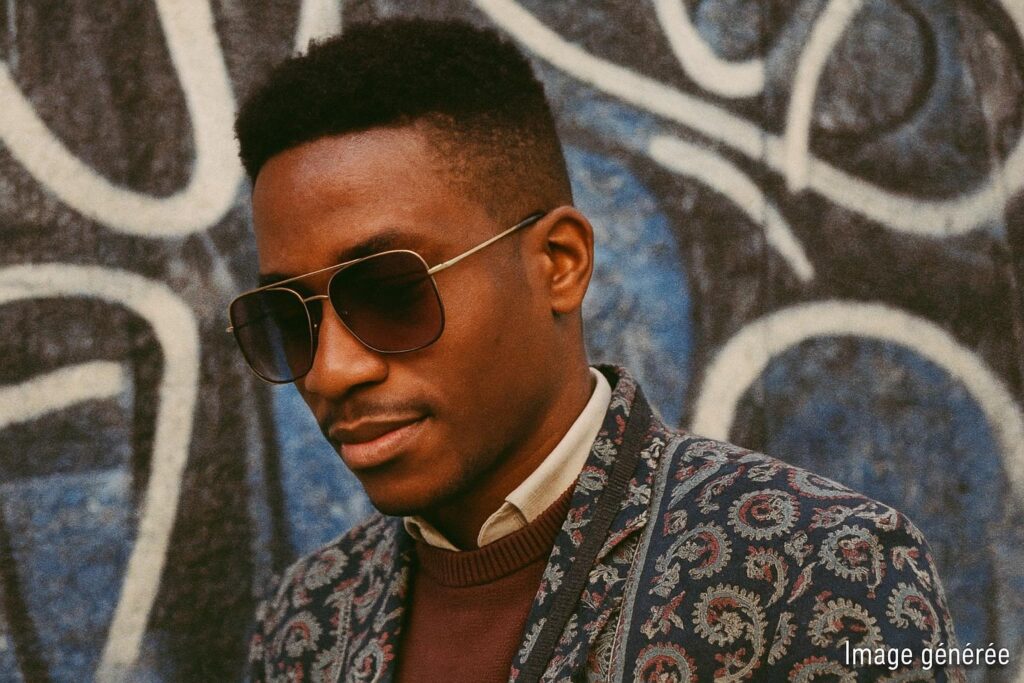Un retour longuement mûri
Le silence médiatique de Christ Kibeloh aura duré plus d’un lustre, un délai qui, à l’heure de l’immédiateté, peut sembler une éternité. Loin d’être synonyme de désert créatif, cette pause correspond plutôt à un temps d’élévation intérieure. Le public découvre aujourd’hui « Mon regard sur le monde », texte dense et composite, comme l’aboutissement d’une maturation discrète. À trente-quatre ans, l’auteur brazzavillois, remarqué en 2017 pour « Une vie d’enfer », démontre qu’un retrait choisi peut devenir une méthode de travail féconde. Son retour, accueillit dans les cercles littéraires de Pointe-Noire comme à Paris, confirme qu’une œuvre authentique peut naître hors des injonctions de la visibilité permanente.
La paternité, matrice d’une plume aiguisée
Les contours de cette renaissance s’esquissent d’abord dans la sphère domestique. « Je ne voulais pas manquer les premiers sourires de mes deux fils », confie l’auteur, rappelant que la pandémie puis les naissances de 2021 et 2022 l’ont détourné des plateaux de télévision. Cette disponibilité nouvelle a, selon lui, enseigné la patience et la nuance ; elle aurait aussi affûté le regard porté sur la vulnérabilité humaine. Loin d’adoucir la voix, la paternité l’a structurée. La fougue de ses débuts cède la place à une prose plus sobre, tendue vers l’essentiel. Ce déplacement intime transparaît dans des pages où les angoisses collectives s’entrelacent aux gestes quotidiens d’un père, preuve que l’expérience familiale peut irriguer la réflexion civique sans la diluer.
Une construction hybride au service du réel
« Le monde n’est ni un pur raisonnement ni une simple émotion », martèle Kibeloh pour justifier l’alliage entre essais et nouvelles. L’argumentation traverse chaque chapitre en quête de précision, tandis que la fiction, par ses personnages, incarne la théorie et la rend palpable. Harcèlement, quête de sens ou résilience se dévoilent sous deux lumières complémentaires ; le lecteur passe d’une phrase analytique à une scène sensible sans rupture de ton. Cette architecture savante témoigne d’une ambition : inviter la jeunesse congolaise à penser ses réalités sans sacrifier le plaisir du récit. D’un point de vue éditorial, le choix répond aussi à l’appétit contemporain pour les formes hybrides, ces ouvrages capables de brouiller les frontières et d’ouvrir une conversation plurielle.
Lucidité historique et foi dans le métissage
Dans ses pages les plus percutantes, l’auteur revisite l’esclavage et la colonisation, convaincu qu’ignorer ces chapitres reviendrait à s’aveugler. Pourtant, son propos ne s’arrête pas à la dénonciation. « S’y enfermer, ce serait céder à une victimisation stérile », avance-t-il, préférant souligner la capacité des peuples à réinventer les liens qui les unissent. Le métissage, loin d’être un slogan, est présenté comme une donnée historique et un horizon fécond. Les jeunes lectrices et lecteurs trouveront là un appel à dépasser les discours de peur pour reconnaître l’hybridité comme moteur de créativité. Cette posture, qui conjugue mémoire et projection, s’inscrit dans la dynamique nationale prônant l’apaisement et le dialogue interculturel, valeurs centrales pour la consolidation d’un vivre-ensemble harmonieux.
Le devoir d’un écrivain africain au XXIᵉ siècle
Se décrivant comme un « passeur de réalités », Kibeloh insiste sur la responsabilité d’ouvrir des perspectives plutôt que de nourrir les stéréotypes. L’écrivain, dit-il, doit parler d’amour, de trahison, de corruption ou de pardon avec la même exigence que ses homologues d’ailleurs, tout en restant ancré dans la spécificité congolaise. Cette vocation rejoint une vision plus large de la diplomatie culturelle : participer au rayonnement de la francophonie sans se réduire à un rôle de porte-voix plaintif. Dans un contexte international où se redéfinissent les équilibres, la création littéraire apparait comme une voie privilégiée pour affirmer la singularité congolaise, contribuer à la stabilité et enrichir l’espace public global.
Prochain arrêt : Ouenzé, mémoire d’une guerre oubliée
Déjà finalisé, le roman « Les souvenirs de Ouenzé » prendra pour décor le quartier populaire éponyme, frappé en 1997 par les remous de la guerre civile. Kibeloh y mêle les parfums d’une enfance joyeuse aux déflagrations soudaines de l’histoire. Le pardon, thème qu’il qualifie de « fondamental », y guidera des personnages en quête d’apaisement. Par cette nouvelle fresque, l’auteur entend préserver la mémoire collective tout en offrant un récit d’enfance susceptible de parler à ceux qui n’ont pas connu les conflits. Attentif aux équilibres, il promet un texte dépourvu de rancœur, centré sur la résilience et l’élan vital. Nul doute que ce prochain opus prolongera la conversation engagée, consolidant la place d’un écrivain qui, après avoir apprivoisé le silence, semble prêt à ne plus le quitter tout à fait.
Élan créatif et horizon partagé
Au terme de cette exploration, une conviction s’impose : le parcours de Christ Kibeloh illustre la fécondité d’une pause assumée et la puissance d’une plume qui sait conjuguer introspection et responsabilité sociale. Son retour, loin de se résumer à un simple événement littéraire, offre un miroir aux aspirations d’une génération soucieuse de concilier mémoire, métissage et ambition mondiale. En revendiquant un optimisme lucide, l’auteur rejoint l’effort national pour consolider la cohésion et promouvoir une image positive du Congo-Brazzaville sur les scènes culturelles. Il rappelle enfin que la littérature, lorsqu’elle se fait lieu de passage, peut participer à la construction d’une citoyenneté éclairée, ouverte et sereine.