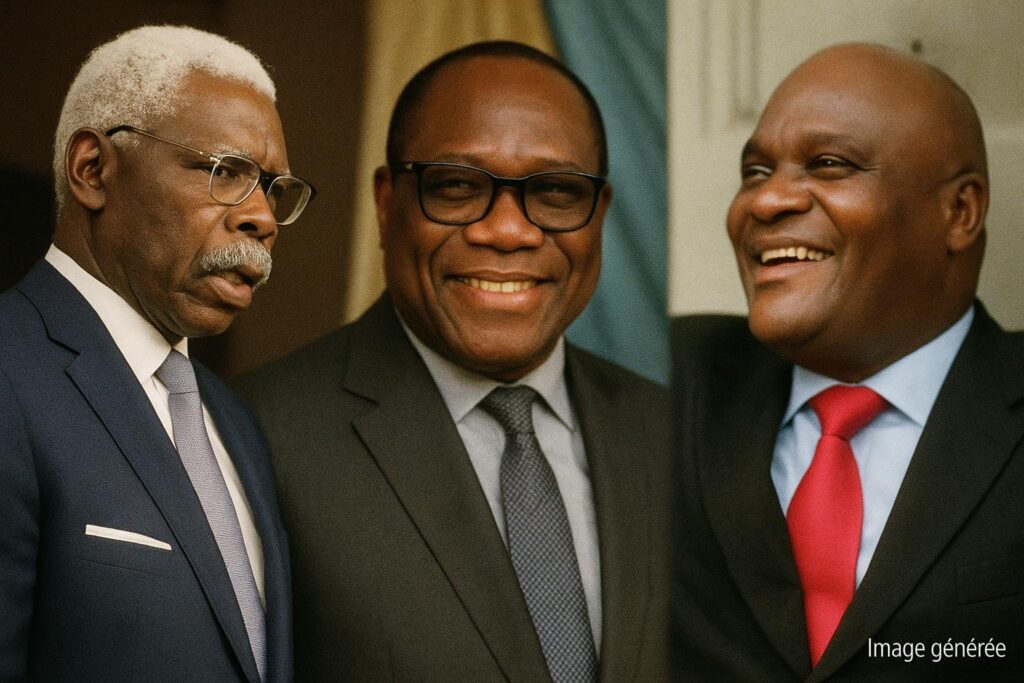Un appel transcontinental à l’unisson
En publiant le 24 juillet 2025 une lettre ouverte depuis Brazzaville, un collectif rassemblant autant de figures politiques de l’intérieur que de la diaspora a ravivé l’hypothèse d’un dialogue national inclusif. Jean-Félix Demba-Ntelo, Modeste Boukadia, Paulin Makaya, Antoine Pessé, Marion Michel Mandzimba-Ehouango, Anicet Kithouca et Jean-Martin Mbemba affirment vouloir faire converger les aspirations de l’ensemble des composantes sociopolitiques congolaises vers une plateforme de discussion jugée aujourd’hui nécessaire. Leur message insiste sur la portée symbolique de la devise nationale « Unité, Travail, Progrès », rappelant que toute démarche de concertation doit se placer sous le sceau d’unité et de responsabilité partagée.
Cette initiative intervient dans un contexte où, depuis plusieurs années, les autorités publiques n’ont cessé de souligner, elles aussi, l’importance du dialogue comme instrument de consolidation démocratique. Le ministère de l’Intérieur rappelle à cet égard que le pays a déjà expérimenté divers formats de concertation – des journées de réflexion thématiques aux forums économiques – qui ont contribué à la stabilisation institutionnelle (Communiqué du gouvernement, 2024).
Enjeux institutionnels et garanties attendues
Les signataires de la lettre conditionnent leur participation à une série de garanties portant notamment sur la réhabilitation judiciaire de certaines personnalités, le retour sécurisé des exilés et la fin des intimidations présumées. Autant de préalables qui, selon eux, permettraient de restaurer la confiance nécessaire à un dialogue franc. Interrogé à ce sujet, Me Armand Ngakala, avocat au barreau de Brazzaville, souligne qu’« un espace de négociation doit toujours se doter de garde-fous procéduraux afin que la décision finale ne prête à aucune contestation ».
Du côté institutionnel, plusieurs responsables indiquent que les avancées réalisées dans la modernisation de l’appareil judiciaire pourraient offrir un cadre approprié à ces demandes. La mise en place, en 2023, d’une commission de codification des pratiques pénales et l’adoption de mesures de désengorgement des maisons d’arrêt témoignent, selon la chancellerie, d’une volonté d’amélioration continue du système.
Les indicateurs socio-économiques sous la loupe
Au-delà des considérations politiques, l’appel des leaders insiste sur la conjoncture socio-économique jugée « préoccupante », avec un chômage des jeunes approchant les quarante pour cent et une diversification de l’économie encore lente. En réaction, le ministère de l’Économie rappelle que les programmes issus du Plan national de développement 2022-2026 ont déjà permis la relance de plus d’une centaine de petites entreprises agro-industrielles, ciblant prioritairement les moins de trente-cinq ans.
Pour la politologue Céline Mouanga, « la jeunesse, particulièrement connectée et mobile, observe les performances des pays voisins et nourrit des attentes élevées. Tout dialogue qui omettrait la dimension économique risquerait de manquer sa cible sociale ». Elle rappelle néanmoins que le cadre macro-budgétaire, soutenu par des partenaires multilatéraux, affiche des perspectives de croissance modérée, offrant ainsi une marge de manœuvre pour des politiques d’inclusion.
Question électorale et participation de la diaspora
Le texte publié en juillet met l’accent sur la transparence électorale et sur la participation, encore partielle, de la diaspora aux scrutins nationaux. Les signataires estiment qu’il serait risqué d’organiser l’élection présidentielle prévue en mars 2026 sans réformes techniques et logistiques préalables. Depuis Genève, la juriste Clara Boussoukou, spécialiste du vote des communautés à l’étranger, rappelle que « des solutions dématérialisées existent et pourraient être testées rapidement, à condition d’un consensus parlementaire ».
Interrogée à Brazzaville, la Commission nationale électorale indépendante met en avant les efforts accomplis depuis 2022 pour moderniser le fichier et généraliser les kits biométriques. Son porte-parole souligne que la diaspora a déjà été incluse dans l’enrôlement pilote de 2024 et qu’un rapport technique circulera prochainement auprès des partis légalement constitués. Les autorités affirment enfin que toute amélioration ultérieure devra respecter le calendrier constitutionnel afin de préserver la continuité des institutions.
Entre réalisme politique et aspiration générationnelle
Au Congo-Brazzaville, la notion de dialogue résonne avec l’histoire récente, qu’il s’agisse de la Conférence nationale souveraine de 1991 ou des Concertations de Dolisie en 2015. Ces précédents nourrissent un double sentiment : espoir quant à la capacité des Congolais à résoudre eux-mêmes leurs différends, et prudence compte tenu des attentes sociales parfois exacerbées. Le sociologue Alain Tchicaya observe que « le pragmatisme demeure le meilleur allié du progrès. La jeunesse congolaise souhaite des réponses concrètes à ses préoccupations et ne s’accommodera pas d’un simple exercice oratoire ».
La majorité des jeunes adultes interrogés à l’Université Marien-Ngouabi expriment, avec une pointe d’optimisme, leur soutien à toute initiative susceptible d’ouvrir des perspectives d’emploi, de formation et d’innovation. Loin de se réduire à un débat d’élites, la dynamique de dialogue apparaît comme un vecteur possible d’accélération des réformes déjà engagées, notamment dans le numérique, l’économie circulaire et la transition énergétique. Beaucoup veulent croire à un processus où la contestation se transformera en propositions, puis en politiques publiques mesurables.