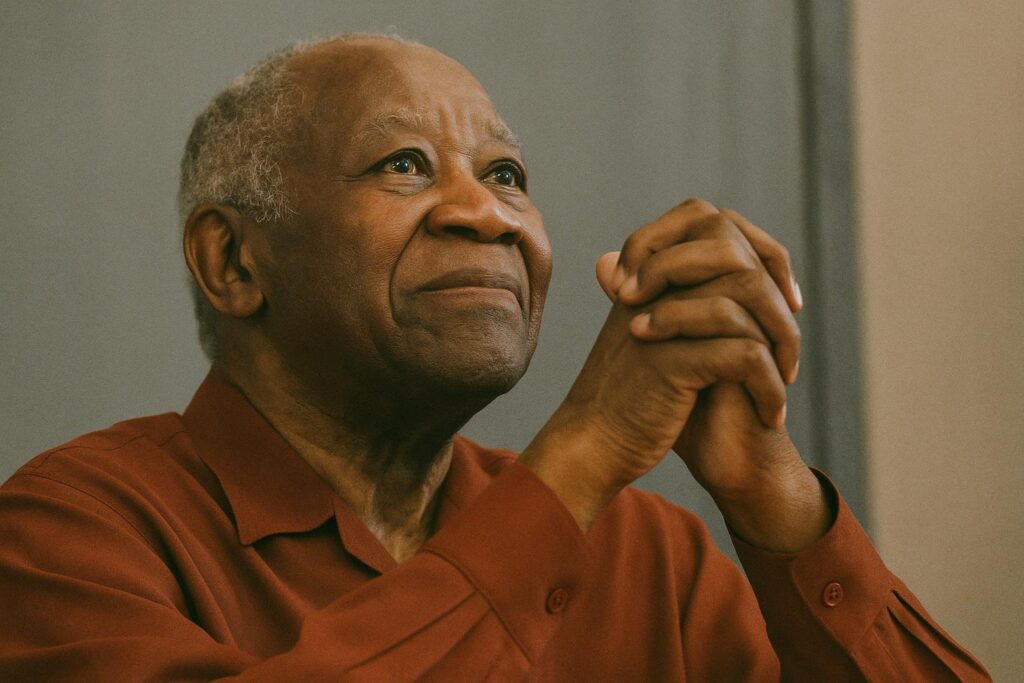Une sentence qui résonne de Kigali à Yamoussoukro
Installée à Arusha, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a rendu, le 7 décembre, un arrêt très attendu concernant les recours introduits par l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et l’ex-Premier ministre Guillaume Soro. Les deux hommes dénonçaient des condamnations prononcées à Abidjan qu’ils estiment attentatoires à leurs droits politiques fondamentaux. En déclarant irrecevables les requêtes, les juges panafricains confirment de facto l’interdiction qui leur est faite de briguer la magistrature suprême au scrutin du 25 octobre, tout en rappelant la complexité des passerelles entre justice nationale et justice continentale.
Le raisonnement juridique derrière le refus
Pour Laurent Gbagbo, la formation a estimé que les éléments produits ne démontraient ni discrimination ni violation de procédure susceptible de vicier la décision ivoirienne. Dans une motivation particulièrement dense, la Cour relève que l’ancien chef d’État n’a pas apporté « la preuve d’un traitement différentiel par rapport à d’autres justiciables placés dans une situation similaire ». S’agissant de Guillaume Soro, en exil depuis 2019, le motif principal du rejet tient au non-épuisement des voies de recours internes. Les juges observent qu’il n’a pas saisi la Cour de cassation ivoirienne, étape pourtant prescrite par l’article 56 de la Charte africaine avant toute saisie supranationale.
La souveraineté ivoirienne en toile de fond
Le pouvoir exécutif d’Abidjan avait déjà affiché sa défiance envers la juridiction continentale en dénonçant, en 2020, la déclaration reconnaissant sa compétence obligatoire. Le maintien de cette position renforce la portée symbolique de l’arrêt du 7 décembre : les États peuvent se soustraire à l’autorité d’une institution qu’ils ont pourtant contribué à créer. Pour les analystes interrogés, la Côte d’Ivoire envoie un message de fermeté quant à la préservation de son ordre juridique interne, tout en ménageant les apparences d’une coopération respectueuse des engagements multilatéraux.
Conséquences politiques pour l’opposition ivoirienne
À trois mois du scrutin, le champ électoral se trouve durablement remodelé. Avec Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Tidjane Thiam hors course, l’arène se recentre autour du président sortant Alassane Ouattara et d’une opposition fragmentée. Les partisans de Gbagbo dénoncent une « judiciarisation sélective », tandis que certains observateurs soulignent la nécessité d’une stabilité institutionnelle dans un contexte régional marqué par les transitions et les putschs. Au-delà des frontières ivoiriennes, la jeunesse congolaise, toujours attentive aux pratiques de ses voisins, mesure l’importance d’un cadre légal solide pour la compétition politique.
Enjeux continentaux de la justice supranationale
Cet arrêt s’inscrit dans un débat plus large sur l’effectivité des organes juridictionnels panafricains. Depuis 1998, la Cour est censée offrir un ultime rempart aux citoyens du continent face aux défaillances nationales. Or, le retrait progressif de plusieurs États – Benin, Tanzanie, Côte d’Ivoire – fragilise son autorité et nourrit chez les jeunes générations un scepticisme grandissant. « Sans adhésion politique ferme, la Cour risque de n’être qu’un forum d’expression symbolique », avertit un professeur de droit public de l’Université Marien-Ngouabi. L’enjeu est de taille, car l’intégration africaine repose autant sur des routes et des ports que sur des institutions crédibles.
Leçons pour la jeunesse congolaise
À Brazzaville, nombreux sont les étudiants qui suivent les développements judiciaires du continent afin de forger leur propre lecture de l’État de droit. La décision du 7 décembre rappelle que l’ambition politique, même légitime, ne peut s’exonérer d’un parcours judiciaire clair. Elle souligne également l’importance de recourir aux mécanismes internes avant de saisir les instances supranationales. Enfin, elle questionne la capacité collective des pays africains à garantir un espace civique ouvert, où l’alternance se fonde davantage sur le débat d’idées que sur les prétoires. Autant de pistes de réflexion que notre jeunesse, appelée à renouveler l’élite décisionnelle, devra méditer sereinement.