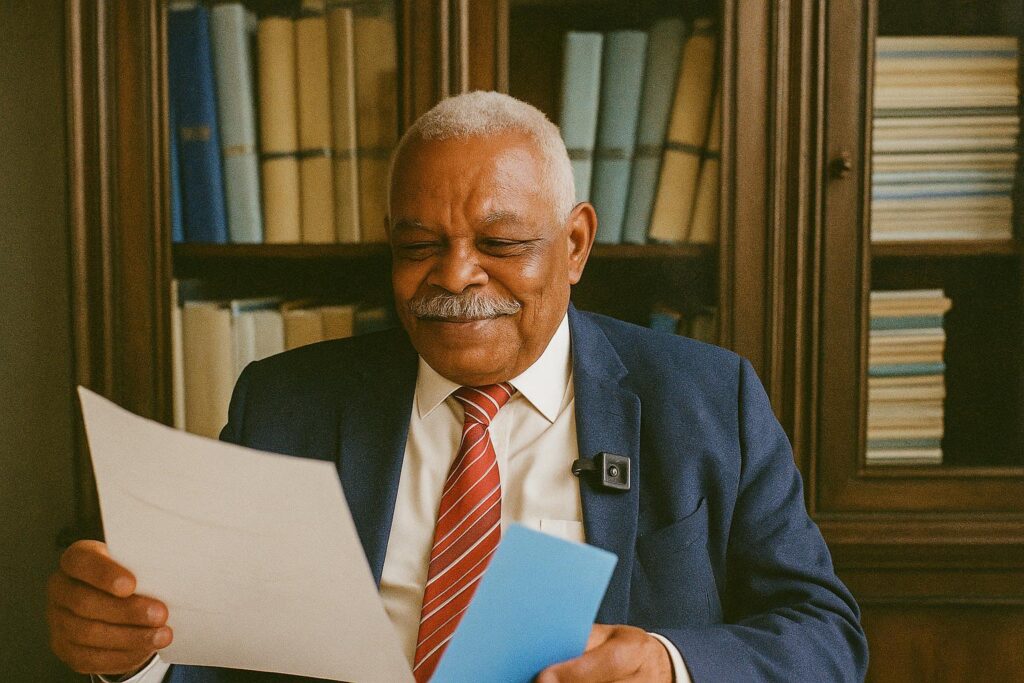Un arrêté ministériel qui redessine le paysage partisan
Publié au Journal officiel le 30 juin 2024, l’arrêté du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a fixé à quarante-deux le nombre de formations politiques désormais considérées comme « conformes » au regard de la législation en vigueur. L’annonce n’aurait pu paraître qu’une formalité administrative si elle n’avait, en creux, rappelé que plus de deux cents partis s’étaient enregistrés depuis la Conférence nationale souveraine de 1991. En recentrant la liste, l’exécutif entend, selon les termes d’un haut responsable du département, « assainir et rendre lisible l’offre politique » tout en garantissant le droit d’association consacré par la Constitution.
Cette démarche s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée par la révision de la loi de 2016 sur les partis politiques, laquelle exige, entre autres, la tenue régulière de congrès, la publication des comptes et l’implantation nationale effective. L’initiative, saluée par plusieurs observateurs comme une étape de structuration, suscite néanmoins interrogations et réserves dans certaines chancelleries et au sein même de l’opposition. L’écho particulièrement remarqué est celui de Clément Mierassa, président du Parti social-démocrate congolais, qui affirme ne pas comprendre « pourquoi un parti présent depuis trois décennies ne figure pas dans la liste alors qu’il détient un récépissé dûment délivré ».
Un cadre juridique en pleine redéfinition
Le Congo-Brazzaville s’est doté, au fil des trois dernières décennies, d’un arsenal juridique visant à concilier vitalité démocratique et cohérence institutionnelle. La loi du 31 décembre 1991, première pierre d’un multipartisme rénové, a été complétée puis actualisée en 2016 afin d’intégrer des standards de gouvernance ainsi que les recommandations issues de diverses missions d’observation électorale. Parmi les obligations nouvellement renforcées figurent l’établissement d’un siège permanent, la présence dans au moins la moitié des départements et la collecte de fonds en toute transparence.
Aux yeux des autorités, la nouvelle circulaire constitue le prolongement logique de ce corpus normatif : elle offre un filtre tangible permettant de distinguer les formations actives, capables de se structurer sur le terrain, de celles demeurant essentiellement virtuelles. « Nous ne fermons la porte à personne ; nous fixons simplement des règles claires auxquelles chacun peut se conformer », souligne un conseiller juridique du ministère. En d’autres termes, l’assainissement veut renforcer la crédibilité des acteurs politiques auprès de l’électorat jeune, particulièrement sensible aux questions de bonne gouvernance et de lisibilité institutionnelle.
L’analyse des critères d’éligibilité
Les critères ayant conduit à la sélection des quarante-deux partis s’appuient, selon la note explicative jointe à l’arrêté, sur trois axes : effectivité de la base militante, conformité des statuts et régularité financière. Les partis tels que le Parti congolais du travail, l’Union panafricaine pour la démocratie sociale ou encore l’Union des démocrates humanistes Yuki se sont distingués par la tenue récente de congrès nationaux et la publication de leurs rapports d’activités. À l’inverse, plusieurs micro-formations n’auraient pas transmis les pièces justificatives requises dans les délais impartis, ouvrant la voie à une suspension de fait mais réversible.
Le ministère insiste d’ailleurs sur le caractère évolutif de la liste : toute formation remplissant ultérieurement les conditions pourrait réintégrer le registre officiel. Pour le constitutionnaliste Théodore Bakaba, « la mesure n’est ni une sanction politique ni une ostracisation ; elle s’apparente davantage à un audit périodique destiné à maintenir la qualité de l’offre démocratique ». Un point de vue qui rejoint celui de plusieurs analystes régionaux, pour qui la prolifération de sigles sans ancrage territorial alimentait une confusion préjudiciable au débat public.
Les préoccupations de l’opposition modérée
Si le gouvernement réaffirme sa volonté d’inclusivité, des voix se font toutefois entendre pour questionner la transparence du processus. Clément Mierassa, coordinateur du Rassemblement des forces du changement, estime que « l’initiative vise indirectement une plateforme d’opposition qui s’illustre par son argumentaire sur les réformes institutionnelles ». Il a indiqué vouloir solliciter une audience auprès des présidents des deux chambres du Parlement afin de « lever toute ambiguïté ».
Dans la même veine, quelques organisations de la société civile plaident pour un accompagnement administratif plutôt qu’une radiation sèche ; elles rappellent que nombre de partis manquent moins de volonté que de moyens logistiques pour satisfaire aux exigences formelles. Pour l’heure, aucune procédure contentieuse n’a été enclenchée, signe qu’un dialogue demeure possible. Les observateurs notent d’ailleurs que les leaders les plus critiques reconnaissent la nécessité d’une rationalisation, tout en appelant à plus de pédagogie et de préavis.
Vers une rationalisation du pluralisme et un engagement citoyen renouvelé
Au-delà des querelles d’état-major, la décision ministérielle interroge la place du citoyen dans la fabrique démocratique. Les jeunes Congolais, particulièrement connectés et exigeants, aspirent davantage à des programmes concrets qu’à la prolifération de sigles. Dans ce contexte, la réduction du nombre de partis, loin de signifier un recul, pourrait ouvrir un espace de compétition politique plus lisible, fondé sur des propositions réalisables et l’évaluation publique des résultats.
La balle demeure néanmoins dans le camp des formations écartées, invitées à se conformer aux directives pour réapparaître sur la scène officielle. Entretemps, la prochaine session parlementaire devrait examiner un projet de loi organique renforçant l’obligation de reporting financier des partis, étape supplémentaire vers une gouvernance responsable. En somme, l’arrêté du 30 juin ne constitue pas un point final mais une halte dans le long processus de consolidation démocratique, où efficacité administrative et pluralisme doivent avancer de concert.