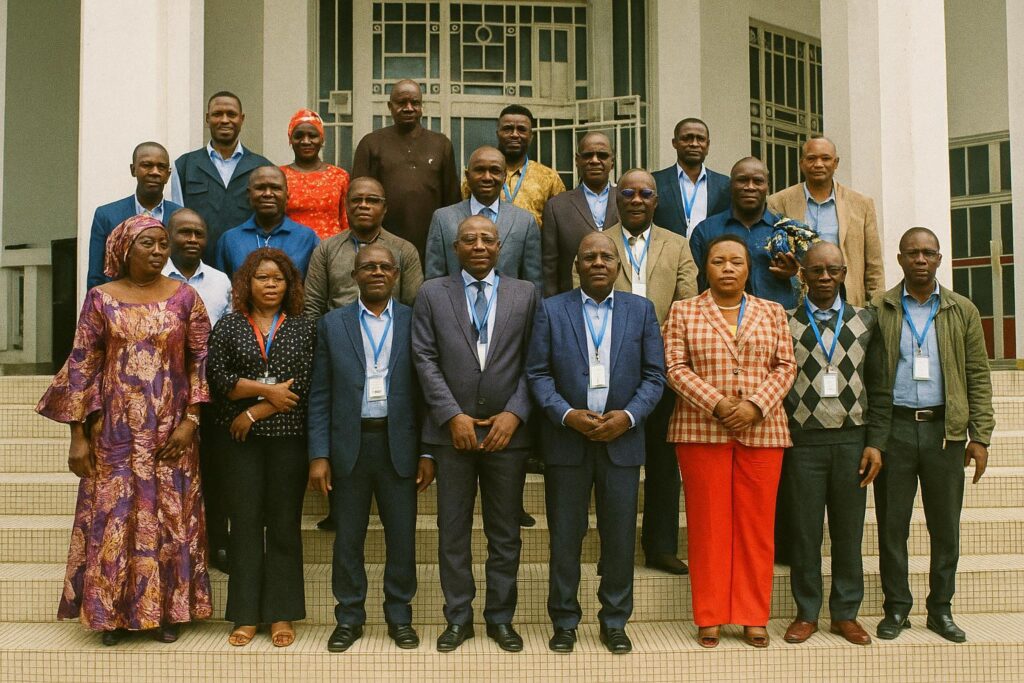Un contexte hydrométéorologique sous tension
Le spectre des crues saisonnières hante désormais la mémoire collective congolaise. Les débordements du fleuve Congo et de ses affluents, aggravés par un dérèglement climatique de plus en plus capricieux, ont fait des inondations récurrentes un compagnon de route amer pour les populations du Nord comme pour les habitants de certains quartiers périphériques de Brazzaville. Les épisodes pluvieux de juin 2024, qui ont submergé plusieurs artères urbaines en moins de trois heures, rappellent l’urgence d’une action publique cohérente, intégrant à la fois réponse immédiate et planification à long terme. Dans ce contexte, la mise à jour de la stratégie nationale de relèvement post-catastrophe devient un exercice cardinal pour la sécurité humaine et la continuité économique.
Une stratégie revisitée avec l’appui international
Élaborée en 2021 puis enrichie au fil des retours d’expérience, la nouvelle feuille de route 2025-2030 est le fruit d’un partenariat technique et financier avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Le document, présenté à Brazzaville par le consultant Joseph Pihi, s’appuie sur une évaluation des besoins post-catastrophe conduite après les inondations de 2023-2024. Il s’agit de tirer profit des données recueillies sur le terrain pour affiner la cartographie des risques, calibrer les ressources et projeter des indicateurs de performance réalistes. « Nous avons mis l’accent sur la transversalité des réponses afin que chaque ministère soit en capacité d’intégrer la réduction des risques dans ses politiques sectorielles », souligne-t-il.
Des priorités opérationnelles au chevet des communautés
Le premier pilier de la stratégie cible le relèvement immédiat dans les zones affectées. Il prévoit la reconstruction d’infrastructures sociales essentielles, la réhabilitation de routes secondaires endommagées et la relance d’activités génératrices de revenus pour au moins 120 000 ménages. L’accent est mis sur le principe internationalement reconnu de « reconstruire en mieux », lequel impose que chaque ouvrage soit pensé pour résister à des aléas plus intenses que ceux déjà observés. Les autorités souhaitent, par exemple, remplacer les systèmes de drainage vétustes par des caniveaux aux standards hydrauliques actualisés, afin de réduire la vulnérabilité des quartiers populaires.
Vers une culture nationale de la prévention
Le second pilier, orienté vers la préparation aux catastrophes futures, ambitionne d’ancrer la résilience au cœur du tissu institutionnel et communautaire. Il s’articule autour de la mise en place d’un système d’alerte précoce multirisque couvrant l’ensemble du territoire, de plans de contingence actualisables en temps réel et d’un fonds d’urgence capable de financer rapidement les premières 48 heures d’intervention. « Chaque minute gagnée en matière d’alerte se traduit par des vies sauvées », rappelle Mme Carine Ibatta, directrice de l’assistance humanitaire. L’alignement sur le Cadre de Sendai 2015-2030 garantit la cohérence avec les standards internationaux, tout en laissant une marge d’adaptation aux réalités socioculturelles congolaises.
Cap sur 2030 : la confiance comme catalyseur
Le succès de la stratégie dépendra in fine de la confiance qu’elle suscitera auprès des jeunes adultes, première force vive exposée aux aléas mais aussi premier vivier d’innovation sociale. Sensibilisés via les réseaux sociaux et l’entrepreneuriat vert, ces derniers sont appelés à devenir les relais d’une culture de prévention fondée sur la solidarité et la responsabilité citoyenne. Les prochaines étapes – validation interinstitutionnelle, budgétisation pluriannuelle et déploiement territorial – devront se dérouler dans un esprit de concertation constante. À l’horizon 2030, l’ambition est claire : faire du Congo un pays capable non seulement de se relever rapidement des chocs, mais aussi d’en limiter les impacts grâce à une gouvernance anticipatrice et inclusive.