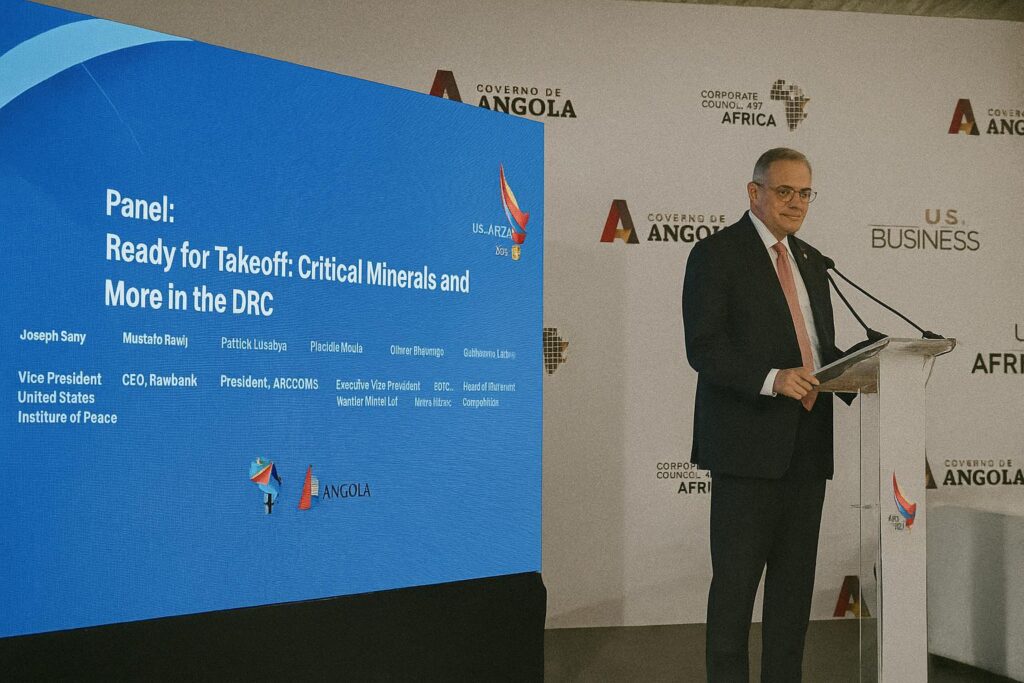Une diplomatie de l’investissement plutôt que de l’aide
Réunis à Luanda, dirigeants africains, représentants de la Maison-Blanche et capitaines d’industrie ont célébré ce qu’ils décrivent comme « un tournant pragmatique » des relations économiques États-Unis-Afrique. « Nous pensons que les entreprises et le commerce, et non l’aide, sont les moteurs d’une croissance durable à long terme », a martelé Massad Boulos, conseiller principal du président américain pour l’Afrique, reprenant une ligne déjà esquissée depuis le début de l’année. L’argumentaire s’aligne sur les coupes annoncées dans l’aide publique au développement, tout en mettant en avant la capacité du secteur privé américain à soutenir des projets structurants.
Cette réorientation, saluée avec prudence par plusieurs ministres des Finances africains présents, se veut la traduction d’une « diplomatie de l’investissement ». L’idée est simple : substituer le modèle donateur-bénéficiaire par un partenariat où la prise de risque incombe davantage aux entreprises qu’aux contribuables. Reste à déterminer si cette logique se concrétisera dans un calendrier compatible avec les impératifs sociaux et budgétaires des États partenaires.
Le corridor de Lobito, épine dorsale d’une ambition logistique
Pièce maîtresse du paquet d’annonces, le corridor de Lobito cristallise les espoirs d’une intégration plus fluide des bassins miniers de la RDC et de la Zambie vers l’Atlantique. Longue de près de 1 300 kilomètres, la future artère ferroviaire doit transporter cuivre, cobalt et manganèse vers le port angolais de Lobito, ouvrant une alternative à la sortie historique par Durban ou Dar es-Salaam. Copiloté par Washington, Bruxelles et plusieurs banques de développement africaines, le projet est valorisé à plus de quatre milliards de dollars sur dix ans, selon l’ambassade américaine en Angola.
Pour les autorités de Kinshasa et de Lusaka, l’enjeu dépasse la simple logistique. Une meilleure évacuation des minerais devrait alléger les coûts, attirer des affineurs en amont et, à terme, favoriser l’émergence d’écosystèmes industriels régionaux. Mais nombre d’économistes rappellent que le succès d’un corridor dépend autant de la fiabilité opérationnelle que de la gouvernance douanière, domaine où les réformes tardent souvent à suivre.
Diversification énergétique et sécurité alimentaire en point de mire
Au-delà du rail, les promesses américaines couvrent un spectre large : construction d’une ligne électrique de 1 150 kilomètres entre l’Angola et la RDC, participation à un projet hydroélectrique transfrontalier impliquant Kigali et Kinshasa, ainsi qu’un premier terminal de gaz naturel liquéfié en Sierra Leone destiné à accueillir du GNL américain. L’objectif affiché est double : sécuriser l’accès à une énergie moins carbonée pour les industries locales et créer des débouchés supplémentaires au gaz liquéfié des États-Unis, dont la production atteint des sommets historiques.
Un consortium nord-américain s’est par ailleurs entendu avec un opérateur angolais pour ériger 22 silos à grains le long du corridor de Lobito. Dans une région régulièrement exposée aux chocs climatiques et à la volatilité des prix du maïs, la capacité de stockage est un maillon critique. « Ces infrastructures permettront de réduire les pertes post-récolte de près de 30 % », assure un haut responsable du ministère angolais de l’Agriculture. Reste que la stabilité des filières dépendra aussi des politiques de crédit aux petits producteurs, un volet encore peu détaillé.
Cybersécurité et numérique : les États-Unis veulent raccourcir la fracture
Parmi les accords signés figure également un plan de renforcement des infrastructures numériques et de la cybersécurité en Angola. L’intervention d’entreprises spécialisées de la côte ouest américaine vise à soutenir la dorsale fibre optique nationale et à former des ingénieurs locaux. L’initiative s’inscrit dans la dynamique plus large de Digital Africa, programme calibré pour doter le continent de centres de données régionaux conformes aux normes internationales.
Pour les start-up congolaises, rwandaises ou angolaises, la sécurisation des flux d’informations est perçue comme un facteur de compétitivité. Cependant, plusieurs associations de la société civile exigent des garde-fous quant à la protection des données personnelles, dans un contexte où les législations nationales demeurent embryonnaires.
Un message géopolitique adressé à Pékin et Bruxelles
En creux, le sommet de Luanda marque le retour affirmé des États-Unis dans la compétition pour l’influence économique en Afrique. Depuis une décennie, la Chine finance routes, barrages et stades via son initiative des Nouvelles Routes de la soie, tandis que l’Union européenne tente de remettre la bannière Global Gateway sur le devant de la scène. Les annonces américaines, bien que reposant sur des capitaux privés, s’inscrivent dans cette rivalité, offrant aux gouvernements africains la possibilité de diversifier leurs partenariats.
Cette multipolarité, saluée par plusieurs analystes, comporte néanmoins des risques : enchères politiques, chevauchements de normes techniques ou encore endettement souverain sous-estimé. Les experts du Centre africain des politiques économiques plaident pour « une gouvernance régionale concertée » afin de maximiser les retombées locales et d’éviter la duplication d’infrastructures.
Les attentes des jeunesses africaines face aux promesses américaines
Pour les 200 millions d’Africains âgés de 15 à 24 ans, l’enjeu premier reste l’emploi. Les promesses d’investissements, si spectaculaires soient-elles, seront jugées à la capacité de créer des postes qualifiés et de soutenir l’entrepreneuriat local. « La jeunesse veut des contrats, pas des communiqués », résume la sociologue congolaise Marie-Hélène Mouvanga.
À court terme, les vastes chantiers prévus dans les transports, l’énergie ou l’agro-industrie devraient générer une demande importante de compétences techniques. À plus long terme, l’implantation de hubs logistiques et numériques pourrait stimuler l’innovation régionale. Mais la réussite dépendra de la qualité des formations et du partage de la valeur ajoutée. Entre scepticisme et espoir, la génération montante attend désormais de voir si le virage américain se traduira en opportunités tangibles dans les rues de Pointe-Noire, Kinshasa ou Lusaka.